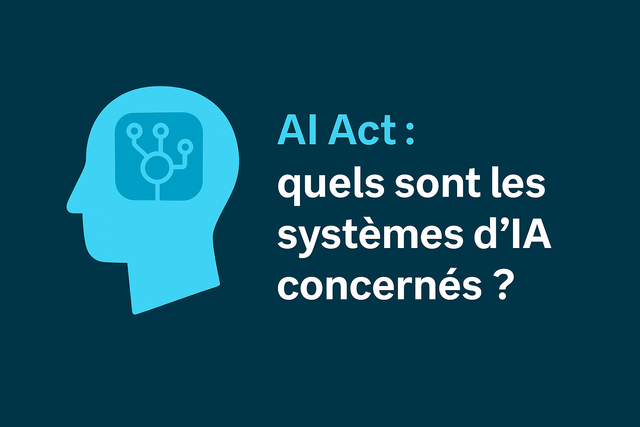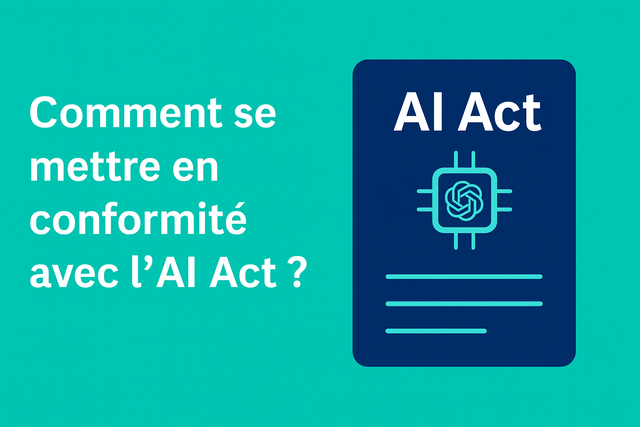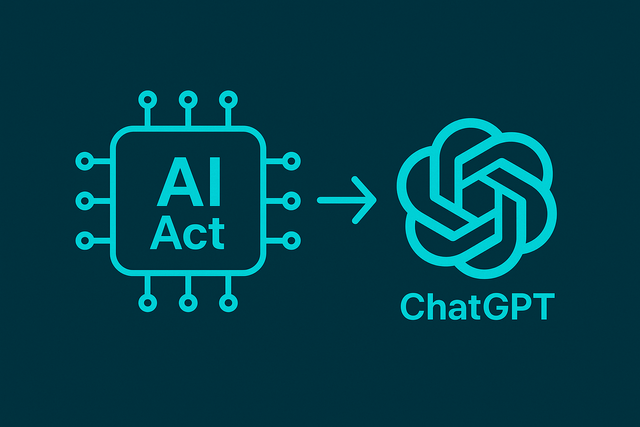5 erreurs à éviter quand on gère un projet de rupture
Contrairement aux idées reçues, un projet de rupture demande du temps. Voici les 5 erreurs à ne pas commettre pour le mener au bout !
Par Philippe Silberzahn – Le 9 mai 2017
Un projet de rupture ne se gère pas comme un projet classique. Les nombreux entrepreneurs qui se lancent dans l’aventure sont souvent tentés de mettre la charrue avant les bœufs. Pour être sûr de mener votre idée à terme, voici les 5 erreurs à éviter dans la gestion de votre projet de rupture.
Extrait de la vidéo de formation MOOC Innovation de Rupture
Prendre la décision d’autonomiser l’entité abritant l’innovation de rupture est un choix important pour une entreprise. Se pose alors la question des moyens qu’elle met en oeuvre pour maximiser les chances de succès de ce projet novateur.
Un projet de rupture logé dans une entité autonome n’est au fond rien d’autre qu’un projet entrepreneurial classique, si ce n’est qu’il est mené au sein d’une entreprise existante. Il faut donc éviter au moins cinq erreurs.
Première erreur : aller trop vite
Chercher à passer à l’échelle trop vite, c’est condamner le projet à l’échec. L’exigence du passage à l’échelle rapide résulte d’un impératif de taille lié au besoin de croissance. Plus la taille de l’entreprise est grande, plus le marché sur lequel elle devra se lancer devra être important pour correspondre à ses objectifs de croissance. Or par définition, il n’existe pas de nouveau marché qui soit très grand.
Le résultat c’est que lorsqu’elle considère un investissement dans un nouveau marché, la grande entreprise poussera pour que les projets innovants atteignent très vite une taille suffisante pour contribuer de façon significative à leur croissance visée.
Néanmoins cette approche repose sur une croyance fausse selon laquelle le développement d’un projet d’innovation de rupture est linéaire.
Non seulement les nouveaux marchés commencent par être très petits, mais ils ont également tendance à le rester assez longtemps. Il y a donc une discontinuité fondamentale dans la naissance d’une innovation :
- d’abord, on assiste à une première période d’incubation incompressible,
- ensuite, si cette incubation est réussie, on peut envisager un passage à l’échelle ouvrant sur la croissance. On ne peut pas forcer cette période d’incubation sans risquer de tuer le projet.
Deuxième erreur : singer l’entrepreneuriat en échouant vite
Une approche qui se développe dans l’entrepreneuriat est celle d’échouer vite (fail early). En substance, l’idée est que comme on ne peut pas trop savoir où l’on va, il faut essayer quelque chose, voir rapidement si ça marche et si ça ne marche pas, abandonner et essayer autre chose. Cette idée est séduisante mais dangereuse car elle repose sur une conception implicite, mais erronée, du processus d’innovation.
L’innovation est un processus social dans lequel l’action de l’innovateur consiste à créer un nouveau réseau de valeur constitué d’un ensemble d’acteurs (clients, fournisseurs, préconisateurs, partenaires, régulateurs, etc.) qui deviennent parties prenantes au projet. La nature sociale de la démarche de l’innovateur en fait donc un processus extrêmement complexe et fastidieux. Cela prend du temps. Ça marche rarement du premier coup. Arrêter dès le premier échec c’est s’empêcher d’apprendre et de réussir. Si Nestlé avait appliqué cette règle, il n’y aurait sans doute jamais eu de Nespresso.
Au lieu d’échouer vite, il faut apprendre à réussir lentement.
Troisième erreur : tout faire pour être le premier
On croit souvent qu’il faut être le premier sur un marché pour réussir. C’est ce que développe l’approche « Océan bleu » par exemple. Or historiquement, ce sont rarement les premiers sur un marché qui en sont devenus les leaders. Ainsi, Gillette est arrivé une bonne vingtaine d’année après les premiers rasoirs en T.
Apple a lancé l’iPhone près de 30 ans après les premiers téléphones mobiles. Sauf dans certains marchés où la notion de base installée peut bloquer de nouveaux entrants tardifs, comme les systèmes d’exploitation, ce qui est important n’est pas d’être le premier, mais d’arriver avec le bon produit qui fera basculer le marché.
Quatrième erreur : mal mesurer la progression
La mesure de progression du projet d’innovation de rupture est extrêmement importante. Dans ce domaine, deux erreurs peuvent être commises.
- La première, c’est de gérer le projet comme un projet d’innovation continu. Or un projet d’innovation de rupture est fondamentalement différent. Le gérer de la même manière, c’est le condamner rapidement à l’étouffement.
- La seconde erreur, c’est d’abandonner toute velléité de gestion au titre que l’innovation, ça ne se gère pas. Mais c’est prendre le risque que rien ne sorte des laboratoires. Il faudra donc développer un système de mesure spécifique pour gérer la progression d’un projet d’innovation. Il n’y a pas de système idéal, il faut le développer de manière empirique.
Cinquième erreur : mal staffer le projet
Choisir le ou la responsable du projet de rupture est très important. Ici, il faudra résister à confier la responsabilité du projet à un « talent ». Bien souvent, ce qu’on appelle talent au sein d’une entreprise, c’est le général de la dernière guerre, le bon élève de l’ancienne activité qui a progressé jusqu’au sommet en évitant de prendre des risques et en développant une grande compétence politique. Ce n’est pas ce dont le projet de rupture a besoin. Ce dont il a besoin c’est quelqu’un qui accepte de prendre des risques, qui est à l’aise avec des situations ambiguës, etc. en bref, il ne faut pas un carriériste, mais un entrepreneur.
Formation « Innovation de rupture »
Envie de former vos collaborateurs ? Inscrivez-les à la prochaine session !
En savoir plusEnvie d’en voir un peu plus ?
-
Le coin des experts
Quels sont les systèmes d’IA concernés par l’AI Act ?
C’est l’impact potentiel sur les droits fondamentaux qui détermine le niveau d’encadrement juridique, et non le secteur ou la taille de l’organisation.
-
Le coin des experts
Comment se mettre en conformité avec l’AI Act ?
L’AI Act, entré en vigueur en août 2024, impose progressivement aux entreprises un ensemble d’obligations autour de l’usage de l’intelligence artificielle.
-
Le coin des experts
Quelle est la règle de l’AI Act concernant ChatGPT ?
L’AI Act encadre ChatGPT comme un modèle d’IA à usage général. Si vous êtes une entreprise utilisatrice, vous devez vous assurer d’un usage conforme.