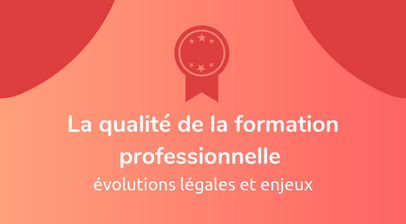
La qualité de la formation professionnelle : évolutions légales et enjeux
Un nouveau cap sera franchi à horizon 2021 avec la nouvelle loi sur la qualité
Par Éléonore Vrillon – Le 7 juin 2019
Après la transposition des normes de qualité du secteur des services au secteur de la formation professionnelle (norme ISO), l’entrée en vigueur de normes françaises sur la qualité des actions de formation (normes NF), l’émergence de différentes certifications et labels qualité en France, l’entrée en vigueur de la loi 2014, un nouveau cap sera franchi à horizon 2021 avec la nouvelle loi sur la qualité.
La qualité, définie au sens large comme “l’ensemble des caractéristiques d’un produit ou d’un service qui lui confèrent l’aptitude à satisfaire les besoins exprimés ou des besoins exprimés ou implicites (…) du client” (ISO/DIS 8402) selon les normes ISO, est progressivement spécifiée et élargie pour prendre en compte les différentes parties prenantes de la formation.
Regardons ensemble les principales évolutions induites par cette nouvelle loi pour les Organismes Prestataires d’Actions concourant au développement des Compétences (OPAC) et ouvrons le débat sur ses possibles conséquences.
Les principales évolutions introduite par la réforme
La notion de qualité dans la formation professionnelle avait été introduite avec la loi du 5 mars 2014 (décret n°2015–790 du 30 juin 2015). Elle se trouve à présent renforcée dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle amorcée par la loi pour la “Liberté de choisir son avenir professionnel” du 5 septembre 2018.
Les évolutions du cadre légal concernant la qualité de la formation professionnelle
Revenons brièvement sur les évolutions suscitées par ce décret en présentant l’ancienne et la nouvelle version de cette norme qualité.
La norme qualité de la loi du 5 mars 2014
Avec la loi du 5 mars 2014, les organismes de formation professionnelle doivent désormais justifier de la qualité des actions de formations financées par les contributions légales. La définition et la vérification de cette qualité passent par la satisfaction de 6 critères, détaillés en 21 indicateurs (Tableau 1).
Pour pouvoir bénéficier d’un financement mutualisé auprès d’un organisme public, l’organisme de formation professionnelle doit apporter les preuves du respect de chacun de ces indicateurs justifiant ainsi de la qualité des actions de formations réalisées. Le respect de ces critères de qualité n’est en revanche pas nécessaire si aucun financement des actions de formation n’est sollicité par l’employeur.
Les organismes de formation ont deux manières de procéder pour apporter ces preuves :
Remplir directement les grilles d’évaluations mises en place par les financeurs de formation
Se munir et justifier d’une certification qualité ou d’un label inscrit et publié par le Conseil National de l’Emploi, de la Formation et de l’Orientation Professionnelle (CNEFOP)
Tableau 1 : Critères et indicateurs de qualité (loi du 5 mars 2014, décret n°2015–790 du 30 juin 2015)
- Décrire les moyens et supports mis à disposition des stagiaires
Critères | Indicateurs |
Critère 1 L’identification précise des objectifs de la formation et son adaptation au public formé | – Produire un programme détaillé pour l’ensemble de son offre, l’exprimer en capacité ou compétence visée |
– Informer sur les modalités de personnalisation des parcours proposés selon le niveau des individus (pré-requis) | |
– Décrire et attester de l’adaptation des modalités pédagogiques aux objectifs de la formation | |
– Décrire les procédures de positionnement à l’entrée et d’évaluation à la sortie | |
Critère 2 L’adaptation des dispositifs d’accueil, de suivi pédagogique et d’évaluation aux publics de stagiaires | – Décrire les modalités d’accueil et d’accompagnement |
– Décrire les conformités et l’adaptation de ses locaux | |
– Décrire son propre processus d’évaluation continue | |
– Décrire les modalités de contrôle de l’assiduité des stagiaires adaptées aux différents formats pédagogiques | |
– Décrire l’évaluation continue des acquis du stagiaire | |
Critère 3 L’adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement à l’offre de formation | |
– Décrire les moyens d’encadrements pédagogiques et techniques | |
Critère 4 La qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés des formations | – Produire et mettre à jour une base des expériences et qualifications des formateurs |
– Attester des actions de formation continue du corps de formateurs / formateur indépendant | |
– Produire les références (disposez-vous de références clients) | |
Critère 5 Les conditions d’information du public sur l’offre de formation, ses délais d’accès et les résultats obtenus | – Capacité à communiquer sur son offre de formation |
– Capacité à produire des indicateurs de performance | |
– Capacité à contractualiser avec les financeurs | |
– Capacité à décrire son périmètre de marché | |
Critère 6 La prise en compte des appréciations rendues par les stagiaires | – Produire des évaluations systématiques et formalisées des actions de formation auprès des stagiaires |
– Décrire les modalités de recueil de l’impact des actions auprès des prescripteurs de l’action | |
– Partager les résultats des évaluations avec les parties prenantes (formateurs, stagiaires, financeurs, prescripteur) dans un processus d’amélioration continue |
La norme qualité de la loi du 5 septembre 2018
Le dernier décret vient enrichir cette première normalisation de la qualité. On passe en effet de 6 critères détaillés en 21 indicateurs, à 7 critères décomposés en 32 indicateurs dont 10 critères spécifiques (Tableau 2). Le nouveau critère prend la place du sixième critère. Il a trait à “l’inscription du prestataire dans son environnement socio-économique” et se décompose en six indicateurs.
Tableau 2 : Critères et indicateurs de qualité (décret en cours d’examen suite à la loi du 5 septembre 2018 ; article du code du travail L. 6316–1)
Critères | Indicateurs |
Critère 1 L’information des publics sur les prestations, les délais d’accès et les résultats obtenus. (ancien critère 5 retravaillé) | – Le prestataire diffuse une information accessible au public, détaillée et vérifiable sur les prestations proposées : prérequis, objectifs, durée, modalités et délais d’accès, tarifs, contacts, méthodes mobilisées et modalités d’évaluation, accessibilité aux personnes handicapées |
– Le prestataire diffuse des indicateurs de résultats adaptés à la nature des prestations mises en œuvre et des publics accueillis | |
– Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il informe sur les taux d’obtention des certifications préparées, les possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que sur les équivalences, passerelles, suites de parcours et les débouchés | |
Critère 2 L’identification précise des objectifs des prestations et leur adaptation aux publics bénéficiaires lors de la conception des actions. (ancien critère 1 retravaillé) | – Le prestataire analyse le besoin du bénéficiaire en lien avec l’entreprise et/ou le financeur concerné(s) |
– Le prestataire définit les objectifs opérationnels et évaluables de la prestation | |
– Le prestataire établit les contenus et les modalités de mise en œuvre de la prestation, adaptés aux objectifs définis et aux publics bénéficiaires | |
– Lorsque le prestataire met en œuvre des prestations conduisant à une certification professionnelle, il s’assure de l’adéquation du ou des contenus de la prestation aux exigences de la certification visée. | |
– Le prestataire détermine les procédures de positionnement et d’évaluation des acquis à l’entrée de la prestation | |
Critère 3 L’adaptation des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et d’évaluation aux publics bénéficiaires lors de la mise en œuvre des actions. (même critère retravaillé) | – Le prestataire informe les publics bénéficiaires sur les conditions de déroulement de la prestation |
– Le prestataire met en œuvre et adapte la prestation, l’accompagnement et le suivi aux publics bénéficiaires | |
– Le prestataire évalue l’atteinte par les publics bénéficiaires des objectifs de la prestation | |
– Le prestataire décrit et met en œuvre les mesures pour favoriser l’engagement des bénéficiaires et prévenir les abandons. | |
– Lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance, le prestataire, en lien avec l’entreprise, anticipe avec l’apprenant les missions confiées, à court et à long terme, et assure la coordination et la progressivité des apprentissages réalisés en centre de formation et en entreprise | |
– Le prestataire met en œuvre un accompagnement socio-professionnel, éducatif et relatif à l’exercice de la citoyenneté. | |
– Le prestataire informe les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et salariés ainsi que des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel. | |
– Lorsque le prestataire met en œuvre des formations conduisant à une certification professionnelle, il s’assure que les conditions de présentation des bénéficiaires à la certification respectent les exigences formelles de l’autorité de certification. | |
Critère 4 L’adaptation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement des prestations lors de la mise en œuvre des actions. (même critère retravaillé) | – Le prestataire met à disposition ou s’assure de la mise à disposition des moyens humains et techniques adaptés et d’un environnement approprié (conditions, locaux, équipements, plateaux techniques…) |
– Le prestataire mobilise et coordonne les différents intervenants internes et/ou externes (pédagogiques, administratifs, logistiques, commerciaux …) | |
– Le prestataire met à disposition du bénéficiaire des ressources pédagogiques et permet à celui-ci de se les approprier | |
– Le prestataire dispose d’un personnel dédié à l’appui à la mobilité nationale et internationale, d’un référent handicap et d’un conseil de perfectionnement | |
Critère 5 La qualification et la professionnalisation des personnels chargés des prestations. (même critère retravaillé) | – Le prestataire détermine, mobilise et évalue les compétences des différents intervenants internes et/ou externes, adaptées aux prestations |
– Le prestataire entretient et développe les compétences des personnels salariés, adaptées aux prestations | |
Critère 6 L’inscription du prestataire dans son environnement socio-économique. (le nouveau critère) | – Le prestataire réalise une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle |
– Le prestataire réalise une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d’intervention, et en exploite les résultats | |
– Le prestataire réalise une veille sur les innovations pédagogiques et technologiques permettant une évolution de ses prestations | |
– Le prestataire mobilise les expertises, outils et réseaux nécessaires pour l’aider à accueillir, accompagner/former ou orienter les publics en situation de handicap | |
– Lorsque le prestataire fait appel à la sous-traitance ou au portage salarial avec une entreprise comme Jump, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel, il s’assure du respect de la conformité au présent référentiel | |
– Lorsque les prestations dispensées au bénéficiaire comprennent des périodes de formation en situation de travail, le prestataire mobilise son réseau de partenaires socio-économiques pour co-construire l’ingénierie de formation et favoriser l’accueil en entreprise | |
– Le prestataire développe des actions qui concourent à l’insertion professionnelle ou la poursuite d’étude | |
Critère 7 La mise en œuvre d’une démarche d’amélioration par le traitement des appréciations et des réclamations (l’ancien critère 6 retravaillé) | – Le prestataire recueille les appréciations des parties prenantes : bénéficiaires, financeurs, équipes pédagogiques et entreprises concernées |
– Le prestataire met en œuvre des modalités de traitement des difficultés rencontrées par les parties prenantes, des réclamations exprimées par ces dernières, des aléas survenus en cours de prestation | |
– Le prestataire met en œuvre des mesures d’amélioration à partir de l’analyse des appréciations et des réclamations |
Des enjeux pluriels suscités par la notion de qualité
Une nouvelle obligation pour les OPAC, une source de professionnalisation des acteurs du secteur ?
Les évolutions de cette norme qualité renforcent ainsi les exigences à satisfaire pour pouvoir bénéficier des fonds publics et mutualisés, désormais gérés et centralisés par la Caisse des Dépôts et des Consignations (CDC).
La réforme introduit un changement d’importance puisque les Organismes Prestataires d’Actions concourant au développement des Compétences (OPAC) se voient obligés, à horizon janvier 2021, de s’aligner sur ce nouveau cadre légal pour obtenir le précieux sésame, cette nouvelle “certification qualité”. Jusqu’alors, le respect des indicateurs, justifiés à l’aide de preuves, permettait le référencement dans Datadock (base de données référençant les organismes de formation professionnelle. La nouvelle certification qualité est, quant à elle, délivrée par des organismes certificateurs accrédités par le Comité Français d’Accréditation (le Cofrac) selon le nouveau Référentiel National Qualité (RNQ) de France Compétences, à l’issue d’un audit. On passe ainsi d’une logique de référencement à une logique de certification.
Cette réforme de la “qualité” a suscité de nombreux échanges et débats entre les acteurs du secteur. Ceux-ci ont, légitimement, touché aux modalités concrètes d’obtention de cette nouvelle certification ou encore à la mise en évidence des évolutions induites par le passage de l’ancienne et à la nouvelle norme (Croüs, 2019, voir aussi par exemple cette comparaison de Johann Vidalenc). L’ensemble de ces mesures, et notamment le nouveau critère, s’inscrivent ainsi dans une dynamique de plus long terme, amorcé dès les années 80 (Bogard, 2001) : celui d’une poursuite de la professionnalisation des acteurs du secteur de la formation professionnelle avec l’introduction d’un nouveau critère prévoyant, entre autres, des activités de veilles réglementaires et technologiques.
Quelles conséquences pour les OPAC ? Si l’on estime qu’il existe 86 000 organismes de formation professionnelle en France (Cnefop, 2018), rappelons qu’un an après la création de Datadock, plus de la moitié de ces organismes de formation ne sont pas encore parvenus à y être référencés, c’est-à-dire à prouver le respect des six critères qualité de la loi de 2015. On peut ainsi supposer que l’entrée en vigueur de cette loi conduira à une nouvelle réduction du nombre d’acteurs en mesure de proposer des actions de formation financées sur les fonds publics mutualisés.
La qualité des effets suscités par la FPC sur le marché du travail : un objectif économique stratégique dans la société de la connaissance
Au-delà d’un d’alignement légal et d’une régulation du secteur par les pouvoirs publics, d’autres enjeux concernant cette notion de qualité dans le marché de la formation professionnelle peuvent être rappelés, (notion que Le Douraon qualifiait d’ailleurs de “concept valise” (1996)).
En effet, historiquement, le développement de cet enjeu de qualité a été associé à un objectif stratégique de la formation professionnelle : celui de mieux faire correspondre l’offre de main d’oeuvre aux besoins du marché du travail. L’évaluation de la qualité d’une formation s’effectue alors dans une perspective économique. Elle doit contribuer à garantir et accroître la compétitivité des économies nationales et européennes (Bonamy & Manenti, 2001). La problématique de la qualité est ainsi associée à celle de l’efficacité économique, dans un enjeu englobant les transformations du marché du travail. On retrouve d’ailleurs bien ces cinq grands enjeux dès le début des années 90 dans le traité de Maastricht*. La qualité du système de formation professionnelle s’évalue à l’aune de ses effets sur le marché de l’emploi, sur sa capacité à accompagner les restructurations et mutations des emplois, à l’émergence de nouveaux métiers, à la reconnaissance des nouvelles compétences (Bogard, 2001).
Dans cette perspective, l’introduction du nouveau critère et notamment les indicateurs sur la “réalisation d’une veille sur les évolutions des compétences, des métiers et des emplois dans ses secteurs d’interventions” ainsi que celui de la mise en oeuvre “d’actions concourant à l’insertion professionnelle ou à la poursuite d’étude” peuvent être perçus comme des signaux forts de la volonté des pouvoirs publics de renforcer ce lien et les effets du passage par la formation sur l’emploi et les carrières professionnelles.
La stratégie de certification : un enjeu économique pour les OPAC en vue de se distinguer sur un marché concurrentiel et opaque
Un autre enjeu structurant dans la réflexion sur la qualité tient à l’utilisation des labels, de chartes ou de certifications qualité par les OPAC comme un atout stratégique en vue de gagner des parts de marché en convainquant de (futurs) clients de leur efficacité (Kremer, 2001), de se distinguer sur un marché particulièrement concurrentiel. Comme l’exprimait Morier dès les années 2000 :
En réalité, les labels fournissent un certain degré de référence sur l’organisme prestataire, sur sa santé financière, son sérieux et son respect de quelques règles déontologiques. Mais ils n’offrent aucune garantie particulière ni sur la qualité même du processus formation qui sera conduit, ni sur les intervenants. (…). Il importe d’ailleurs de ne pas sous-estimer l’intérêt commercial que représente l’image d’un label face au marché des prestations; c’est probablement l’une des principales raisons de l’engagement des opérateurs dans ces démarches. (Morier, 2001, p. 153)
En janvier 2021, la nouvelle obligation légale aura contribué à distinguer les OPAC en capacité de réagir et de s’aligner, d’administrer les preuves, de plus en plus fines et précises de la qualité de leurs actions de formation (correspondant aux sept nouveaux critères). La qualité ne sera plus une manière de se positionner sur un marché, de se distinguer (Vial, 2001; Le Douaron, 2001), mais bien une condition nécessaire pour exister.
Cette loi semble contribuer à la dynamique d’une plus grande transparence de l’offre sur un marché considéré comme opaque, au regard de la diversité des acteurs et de l’offre (Bonamy & Manenti, 2001). En mutualisant les critères d’évaluation au niveau national, l’appréciation de la qualité des actions de formation doit permettre de faciliter le choix et l’identification du “bon” prestataire ou de la “bonne” action de qualité pour les acheteurs (Bonamy & Manenti, 2001 ; Bogard, 2001).
Dans ce contexte de régulation accrue ainsi que d’une rationalisation des dépenses de formations, on peut toutefois supposer que les OPAC sauront trouver ou inventer de nouveaux arguments pour se distinguer.
La qualité de l’action de formation : le point de vue des apprenants
Pourquoi pas, d’ailleurs, imaginer que ces stratégies de distinction trouveront désormais leur source dans la qualité de l’expérience de formation. En effet, pendant longtemps, l’apprenant a été absent des débats relatifs à la qualité, alors même qu’il est l’un des bénéficiaires directs des actions de formations. André Voisin écrivait d’ailleurs à ce sujet un article au titre éloquent : “l’apprenant introuvable” (2001, p. 63). Or, la prestation de formation fait intervenir trois principaux acteurs pour lesquels on repère bien que les critères de qualité ne peuvent être les mêmes (Kremer, 2001).Considérer le point de vue de l’apprenant dans la qualité d’une action de formation n’est pourtant, là encore, pas une chose aisée (surtout pour un organisme de formation qui reste souvent éloigné du moment de la collecte des besoins dans le contexte de l’emploi).
Différents niveaux peuvent être pris en compte, par exemple :
L’identification de ses besoins de formation et son adéquation à une offre de formation adaptée
L’identification de son niveau de connaissances et compétences avant de débuter la formation
L’identification de ses manières d’apprendre et l’offre d’une action de formation adaptée à son style d’apprentissage
L’utilité et l’efficacité suscitées par le passage en formation en situation de travail, les possibilités de transfert.
Lorsque l’on retient le point de vue de l’apprenant, la qualité d’une action de formation peut donc tout autant renvoyer aux conditions d’accès à la formation, qu’à de l’ingénierie de formation pour proposer ou sélectionner une formation adaptée aux besoins identifiés ou encore à la manière de penser et d’adapter le dispositif de formation d’un point de vue pédagogique pour soutenir son apprentissage. La qualité peut aussi tenir aux effets suscités par le passage en formation. Il reste que l’évaluation de ces dimensions requiert des critères exigeants et un processus complexe. Dans le décret de 2015, on repère bien l’introduction de cette dimension : on cherche à vérifier que l’organisme de formation propose des dispositifs adaptés aux “stagiaires” ou encore à bien recueillir leurs appréciations pour progresser. Celle-ci est, sous certains aspects, renforcée par la nouvelle réforme de la qualité.
Conclusion : une réforme aux effets encore incertains
La prochaine entrée en vigueur de la réforme sur la qualité de la formation professionnelle s’inscrit donc dans la continuité d’une dynamique visant à sa normalisation. L’Etat devient un régulateur central du secteur et les acteurs de la formation professionnelle sont de plus en plus encadrés. Ceux-ci sont censés gagner en professionnalisme et le secteur en transparence. Leurs actions sont censées être plus adaptées et efficaces pour répondre aux besoins économiques d’un marché du travail en mutation tout en correspondant au mieux aux besoins de développement des compétences des apprenants.
Cette réforme constitue ainsi un réel challenge pour les professionnels du secteur s’ils veulent pouvoir accéder aux financements publics mutualisés : leur existence dépend de leur capacité à s’adapter. Et ce challenge paraît d’autant plus important que l’incitation à se former, par le canal individuel et les fonds mutualisés, est renforcée, à l’aide de l’emblématique Compte Personnel de Formation (CPF).
Il reste que, pour la mise en oeuvre de cette évolution qualité, concernant l’ensemble des parties prenantes des acteurs de la formation, devra faire l’objet d’une véritable évaluation. De nombreuses questions restent en suspens quant aux conséquences de ce changement :
Qu’en est-il des institutions qui veilleront à son application ? Quels procédés et rythmes de contrôle seront retenus ?
Quels seront réellement les OPAC en mesure de s’adapter ? Quelles en seront les conséquences pour ce secteur ?
Cette réforme aura-t-elle des effets sur la manière de concevoir des dispositifs de formation professionnelle ?
Cette réforme de la qualité sera-t-elle une occasion de faire évoluer les pratiques et manières de concevoir des dispositifs de formation professionnelle tout en tenant compte des besoins des apprenants?
Quels seront les impacts pour les apprenants sur la montée en compétence, sur leur efficacité ou sur le bien-être dans l’emploi ?
Ira-t-on vers une plus grande transparence des méthodes et des résultats de ces évaluations ?
On ne peut que s’accorder sur le fait que la recherche de la qualité de la formation professionnelle est un idéal à atteindre. En ce sens, cette réforme offre une belle occasion de répondre à ce défi. Mais faut-il encore que tous les acteurs y participent réellement, que de l’énergie soit allouée pour que collaborent les différentes parties prenantes et qu’ils soient en mesure d’évaluer, à l’aide des indicateurs adaptés les efforts et actions qu’ils conduiront en ce sens.
*(1) faciliter l’adaptation aux mutations industrielles notamment par la formation et la reconversion professionnelles ; (2) améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l’insertion et la réinsertion sur le marché du travail ; (3) faciliter l’accès à la formation professionnelle et favoriser la mobilité des formateurs ainsi que des personnes en formation et notamment des jeunes ; (4) stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d’enseignement ou de formation et entreprises ; (5) développer l’échange d’informations et d’expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des Etats membres.
Références bibliographiques
Bogard, G. (2001). LEs trois âges de l’Europe de la formation : la qualité comme levier. Education permanente, 2(147), 35–62.
Bonamy, J. & Manenti, Y. (2001). Les débats sur la qualité de la formation continue : particularismes régionaux et convergence européenne. Education permanente, 2(147), 19–34.
Croüs, S. (février 2019). Datadock VS la future certification qualité applicable aux OPAC : changement de regard sur la qualité de la formation professionnelle. Disponible ici.
Cnefop (2018). Rapport faisant synthèse des démarche qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs 2017.
Kremer, X. (2001). (Trans)-formation de l’apprenant et la qualité de la formation. Education permanente, 2(147), 87–97.
Le Douraon, P. (2001). Une vision renouvelée de la qualité en formation : avancées et limites. Education permanente, 2(147), 141–150.
Morier, F. (2001). De la qualité de la formation à la reconnaissance des formations, Education permanente, 2(147), 151–158.
Vial, M. (2001). Les missions du formateur et la qualité : entre désignation et attribution. Education permanente, 2(147), 117–130.
Voisin, A. (2001). L’apprenant introuvable. Education permanente, 2(147), 63–75.
Ce sujet vous intéresse ? Téléchargez notre Livre Blanc dédié à l’évaluation de l’efficacité des formations
« Méthodes et outils pour évaluer l’efficacité de vos formations »
En savoir plusEnvie d’en voir un peu plus ?
-
Recherche & Développement
Gestion des talents à l’ère de l’IA : préparez l’avenir
Découvrez comment l’IA transforme les métiers et comment adapter vos stratégies RH pour accompagner vos collaborateurs dans cette transition.
-
Recherche & Développement
Comment utiliser l’IA pour bâtir son plan de développement des compétences ?
L’accélération des transformations technologiques, portée notamment par l’IA, impose aux entreprises de repenser leurs stratégies de formation.
-
Recherche & Développement
10 exemples d’intelligence artificielle en entreprise
L’intelligence artificielle (IA) est devenue un levier essentiel pour l’innovation et la transformation numérique dans les grandes entreprises.



